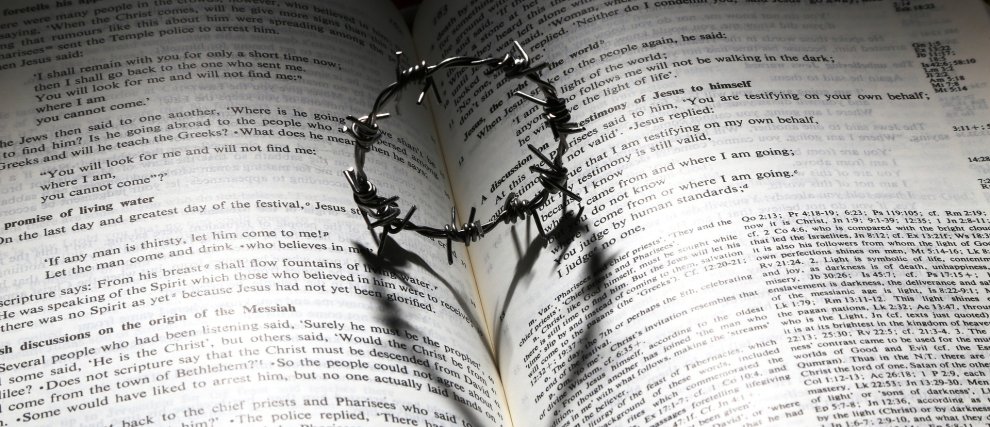Sainte Marguerite d’Youville : vie, fondation et prière
Sainte Marguerite d’Youville était une religieuse québécoise du XVIIIème siècle. Fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal (désormais appelées les Sœurs Grises), elle a également été l’administratrice de l’Hôpital général de Montréal. Béatifiée le 3 mai 1959 par le pape Jean XXIII, elle a ensuite été canonisée le 9 décembre 1990 par le pape saint Jean-Paul II. Sainte Marguerite d’Youville est la première canadienne à avoir été canonisée. Par ailleurs, les Sœurs de la Charité sont aussi la première communauté religieuse fondée au Canada.
Biographie de sainte Marguerite d’Youville
Enfance, mariage et vie de famille
Marguerite d’Youville est née le 15 octobre 1701 à Varennes, près de Montréal en Nouvelle-France (ensemble de territoires coloniaux français d’Amérique septentrionale). Elle est issue de la noblesse coloniale, son grand-père avait été gouverneur de Trois-Rivières. Marguerite a deux sœurs et trois frères. À onze ans, elle étudie chez les Ursulines, à Québec et y reste deux ans. Elle rentre chez elle car elle doit aider sa mère, Marie-Renée Gaultier, désormais veuve. En 1719, sa mère se remarie avec Timothy Sullivan , un chirurgien irlandais. Ce mariage entraîne l’annulation du mariage de Marguerite avec Louis-Hector Piot de Langloiserie, fils du seigneur de l’île Sainte-Thérèse. En effet, les parents de ce dernier considèrent que Marie-Renée a fait une mésalliance en épousant Timothy, un roturier, qui a d’ailleurs une très mauvaise réputation en Nouvelle-France. En 1721, Marguerite déménage avec sa mère et son beau-père à Montréal. Le 12 août 1722, Marguerite épouse François-Madeleine d’Youville. Le couple accueille ensuite six enfants : Timothée (qui meurt peu de temps après sa naissance en 1723), Joseph-François (né en 1724 et qui deviendra prêtre), Ursule (née en 1725), Marie-Louise (née en 1727), Charles-Marie-Magdeleine (né en 1729, qui deviendra prêtre également) et Ignace (né en 1731 qui meurt peu de temps après). Malheureusement, le 4 juillet 1730, François-Madeleine meurt subitement. Il laisse Marguerite veuve à 28 ans, enceinte, et quatre jeunes enfants. De surcroît, il lui laisse une succession totalement endettée. Marguerite s’en sépare donc. Téméraire, elle monte un commerce et fait montre de talents d’administratrice.
Fondation des Sœurs de la Charité de Montréal
En 1737, Joseph-François entre au séminaire de Québec, suivi par Charles-Marie en 1742. Le 31 décembre 1737, avec trois autres femmes (Catherine Cusson, Marie-Catherine Demers Dessermont et Marie-Louise Thaumur de La Source), elles décident de consacrer leur vie aux pauvres. Elles fondent ainsi une petite association séculière et prononcent des vœux. En 1747, le Supérieur Normant du Faradon rédige les “engagements primitifs” de la petite communauté. À cette époque, Marguerite est assez affaiblie par des problèmes de santé.
Direction de l’Hôpital général de Montréal
À la fin des années 1740, les Frères hospitaliers de la Croix et de Saint Joseph manifestent le désir de se détacher de la gestion de l’hôpital général de Montréal, anciennement nommé l'Hôpital général des Frères Charon. Les Sulpiciens font tout pour que la direction de l’établissement revienne à Marguerite et à sa communauté. Ils y parviennent. Toutefois, c’est un établissement fort endetté et en mauvais état dont elle hérite. Courageuse et déterminée, elle s’y installe tout de même, le 7 octobre, avec six consœurs. Elles réaménagent tout. Jusqu’à lors, l’hôpital était réservé aux hommes. Désormais, il est ouvert aux pauvres hommes et femmes, aux soldats infirmes, aux personnes âgées hommes et femmes, aux filles mères, aux orphelins et aux enfants trouvés.
En octobre 1750, l’intendant François Bigot émet une ordonnance révoquant la gestion de l’hôpital par les Sœurs de la Charité et unissant l’Hôpital général de Montréal à celui de Québec. Faisant cela, il obéit à la demande du roi de voir diminuer le nombre de nouvelles communautés religieuses au Canada. Or, Marguerite n’est pas décidée à abandonner son hôpital et rédige alors une supplique pour s’opposer à cette décision, rappelant toutes les améliorations apportées à l’établissement depuis qu’elle en est la directrice. C’est ainsi que le 19 juin 1750, mère d’Youville se rend à Québec présenter sa supplique à l’intendant Bigot et à Mgr de Pontbriand. Marguerite peut compter sur le soutien du supérieur de la Compagnie de Saint-Sulpice à Paris, Jean Couturier, et du supérieur Normant Faradon. En 1751, un arrêt du Conseil du roi annule l’ordonnance de Bigot et demande que soit conclu un contrat avec Marguerite pour l’administration de l’hôpital. Le contrat est officiellement établi par une ordonnance le 28 septembre 1752. Après avoir reçu ses lettres patentes en 1753, la communauté devient responsable de l’administration de l’Hôpital général. Les membres de l’association sont également appelées dès lors les Sœurs de la Charité et reçoivent l’habit gris, qui leur vaut le surnom de sœurs grises. En 1755, Mgr de Pontbriand confirme la règle écrite par le père Normant Faradon en 1747.
Guerre de Sept Ans
En 1756, la guerre de Sept Ans éclate entre l’Angleterre et la France. Mère d’Youville est à pied d’œuvre et soigne les blessés anglais et français. Son fils, Charles-Marie-Magdeleine, alors curé à Pointe-Lévy, est fait prisonnier par les Britanniques lors du siège de Québec. Il reste incarcéré jusqu’en septembre 1759.
La guerre met à mal les finances de la communauté. Ainsi, quand la Nouvelle-France capitule en 1760, l’Hôpital est lourdement endetté, comme toutes les autres communautés religieuses et plus généralement l’ensemble des Canadiens. Ils attendent tous le traité de paix de février 1763 pour connaître leur sort. Tous perdent beaucoup.
Incendie de Montréal
Le 18 mai 1765, un incendie ravage une immense partie de Montréal. 111 maisons sont détruites par les flammes, dont l’Hôpital général. 18 sœurs, 17 dames qui payaient une pension, 63 pauvres et 16 enfants abandonnés se retrouvent sans toit. Ils sont recueillis temporairement par l’Hôtel-Dieu. Le supérieur des Sulpiciens prête 15 000 livres pour la reconstruction de l’Hôpital. Ce n’est que sept mois plus tard que tous les délogés regagnent l’Hôpital. Entre-temps, le 8 juin 1765, Marguerite fait l’acquisition de la seigneurie de Châteauguay. Elle y fait construire un moulin afin de générer des revenus et de pouvoir nourrir les pensionnaires de son établissement.
Fin de vie de Marguerite
Sainte Marguerite d’Youville rend son âme au Seigneur le 23 décembre 1771, dans une chambre de son hôpital, âgée de 70 ans. Elle est fêtée au Canada le 16 octobre et, selon le martyrologe romain, le 23 décembre.
Sa dépouille a été déposée dans la Basilique Sainte-Anne de Varennes le 8 décembre 2010.
Prière à sainte Marguerite d’Youville
“Ô sainte Marguerite d'Youville femme d'écoute et de compassion ta vie est page d'évangile qui inspire notre action.
Prête-nous tes yeux pour découvrir les besoins les plus urgents de notre époque.
Prête-nous tes oreilles pour entendre les cris de souffrance et de détresse.
Prête-nous tes mains pour panser les blessures et apaiser la douleur.
Prête-nous surtout ton cœur pour manifester la tendresse divine dans un amour sans frontière.
Prie le Père de nous donner comme il l'a fait pour toi une foi audacieuse une espérance invincible une charité universelle.
Amen.”
Continuez votre prière avec sainte Marguerite d’Youville grâce à Hozana !
Avec Hozana, ! En priant avec les saints, vous découvrirez la puissance de la communion des saints !
Avec sainte Marguerite d’Youville et sainte Marguerite Marie, et !
- https://www.reflexionchretienne.fr/pages/vie-des-saints/octobre/sainte-marie-marguerite-d-youville-veuve-et-fondatrice-de-la-congregation-des-s-urs-de-la-charite-au-canada-1701-1771-fete-le-16-octobre.html
- https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19901209_youville_fr.html
- https://nominis.cef.fr/contenus/saint/2029/Sainte-Marguerite-Marie-d-Youville.html