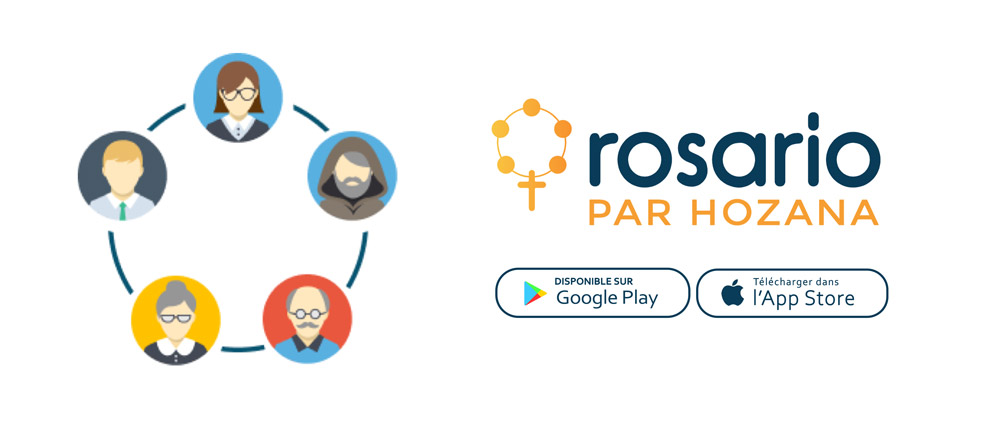Transhumanisme : définition, vision de l’homme et dangers
Le transhumanisme est un courant de pensée, une idéologie qui revendique l’usage combiné des sciences et des techniques (biotechnologies, nanotechnologies, intelligence artificielle, etc) dans le but d’améliorer la condition humaine et de repousser les limitations qui lui incombent. Ce mouvement est une forme technicisée de la spiritualité du New-Age, qui cherche à déployer le plein potentiel humain. Derrière ce mouvement du transhumanisme, l’idée est de dépasser l’être humain pour en faire un “post-humain” ou “transhumain” aux capacités physiques, cognitives et intellectuelles illimitées. L’homme pourrait ainsi devenir un être éternel, incorruptible et autosuffisant. Cet idéal, bien que très séduisant, cache des dangers éthiques, des intérêts économiques et politiques ainsi qu’une vision de l’Homme parfaitement incompatible avec la foi chrétienne.
Qu’est-ce que le transhumanisme ?
Définition du transhumanisme
Le transhumanisme est une idéologie contemporaine qui promeut l’amélioration radicale de la condition humaine grâce aux avancées technologiques, scientifiques et médicales. En 1957, Julian Huxley définit ainsi le transhumain : “Un homme qui reste un homme mais qui se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de et pour sa nature humaine”. Ce mouvement de pensée n’a pas pour but de soigner une défaillance individuelle et biologique de l’Homme, comme le fait la médecine, mais vise à le transformer, le dépasser, voire le réinventer. À travers les biotechnologies, les nanotechnologies, les interfaces cerveau-machine, ou l’intégration de l’intelligence artificielle dans le cerveau humain, le transhumanisme cherche à donner naissance à un "homme augmenté", libéré de ses limitations biologiques et psychiques naturelles.
Une vision de l’Homme augmenté
Cette ambition de transformation repose sur une vision matérialiste de l’être humain, le réduisant à la somme de ses parties matérielles, à un ensemble de circuits neuronaux et de processus biochimiques. Ainsi, le corps humain devient un support perfectible, une simple plateforme qu’il conviendrait d’optimiser pour tendre vers l’immortalité, l’incorruptibilité ou encore l’autosuffisance. Le rêve ultime du transhumanisme est celui d’un "posthumain", un nouvel être, débarrassé de la vieillesse, des maladies et, à terme, de la mort elle-même. Dans cette perspective, le corps n’est considéré que comme un obstacle à contourner, un support à perfectionner. La finalité étant de parvenir à une autosuffisance radicale, à une incorruptibilité quasi divine, à une immortalité technologique. Le transhumanisme aspire ainsi à produire un "posthumain", une nouvelle espèce hybride, affranchie de toute dépendance biologique, capable de se maintenir à l’infini, voire de migrer sa conscience dans des supports artificiels. Derrière cette quête de dépassement se profile une forme moderne de gnose (doctrine ésotérique selon laquelle le salut de l’Homme ne viendrait pas de l’incarnation du Christ, mais grâce à une connaissance révélée à une certaine élite, par des moyens ésotériques), où le salut ne passe plus par la grâce, mais par la technologie toute-puissante. Pour certains, cette idéologie d’homme augmenté peut s’ancrer dans une volonté d’améliorer la vie des hommes en général, pour d’autres, elle se révèle être une aubaine économique.
Des intérêts économiques, sociaux et politiques
Il est important de prendre en compte les différents intérêts économiques, sociaux et politiques qui peuvent motiver certains acteurs du marché. En effet, le transhumanisme représente un marché en plein essor, porté par les géants de la tech et les biotechnologies, ayant pour but de transformer l’être humain en produit optimisable. Derrière les promesses d’intelligence augmentée et d’immortalité, se cachent d’immenses intérêts économiques. L’Homme devient un consommateur permanent de solutions technologiques, toujours perfectible, donc toujours rentable.
Les dangers du transhumanisme
Inégalités sociales du transhumanisme
L’idéologie transhumaniste, bien que prometteuse sous certains aspects, comporte de nombreux risques et dangers qu’il est important de considérer. D’un point de vue de la société, le marché transhumaniste est pour l’instant dominé par une certaine élite technologique. Les produits et services qui découlent de ce marché coûtent un prix particulièrement élevé. Cela génère des inégalités sociales entre les personnes capables de s’offrir ces nouvelles technologies et les autres. De plus, ce marché favorise une marchandisation du vivant faisant de certaines parties du corps humain des produits consommables et interchangeables.
Transhumanisme et eugénisme : vers une rupture de l’espèce humaine
En plus d’un désordre sociétal, l’idéologie transhumaniste met en péril l’intégrité de l’espèce humaine. Dans son livre “Demain les posthumains”, Jean-Michel Besnier met en garde contre une nouvelle forme d’eugénisme modernisé, qui viendrait contrôler les caractéristiques des êtres humains. Cet eugénisme technicisé annonce une rupture anthropologique en substituant à l’héritage biologique aléatoire un projet d’optimisation, planifié et dirigé, où l’humain devient un objet à paramétrer plutôt qu’un sujet à accueillir dans sa singularité. De plus, des chercheurs alertent sur des effets imprévus des modifications génétiques sur l’espèce humaine et sur la dissémination incontrôlée de ces gènes modifiés dans la population. Le transhumanisme vient également nier la part de liberté inhérente à la nature humaine.
Programmation ou liberté humaine ?
Beaucoup de transhumanistes considèrent le cerveau et l’esprit humain comme un programme informatique interchangeable. Ils nient par là la complexité émotionnelle et la dimension spirituelle de l’homme qui sont pourtant des caractéristiques inhérentes à la nature humaine. Dans cette même idée, considérer l’être humain comme un produit modelable et programmable vient nier la liberté propre à l’intelligence humaine. L’homme est un être rationnel dont les choix sont conduits par son intelligence. L’idéologie transhumaniste n’est pas seulement dangereuse d’un point de vue éthique, à l’échelle de la société et de l’espèce. C’est aussi un mouvement particulièrement incompatible avec la foi chrétienne.
Incompatibilité entre transhumanisme et foi chrétienne
On pourrait dire que le transhumanisme pose un vrai constat de la condition humaine. À savoir que l’homme est un être corruptible, mortel et limité dans ses capacités physiques et cognitives. Seulement la réponse proposée face à cette réalité n’est pas la même entre l’idéologie transhumaniste et la foi chrétienne. Là où la foi chrétienne voit en l’Homme un être créé, aimé, vulnérable et appelé à la communion divine, le transhumanisme propose un homme auto-construit, autonome, maîtrisant sa propre destinée. Cette opposition s’articule à plusieurs niveaux fondamentaux.
Une vision de l’Homme opposée à l’anthropologie chrétienne
Le transhumanisme repose sur une conception matérialiste de l’être humain comme entité modulable, modifiable sous tous ses aspects. L’homme n’est plus un don reçu, mais un projet technique, un produit en constante amélioration. Cette vision contredit profondément l’anthropologie chrétienne, qui affirme que l’homme et la femme sont créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, et dotés d’une dignité intrinsèque et inaliénable. L’être humain, dans la religion chrétienne, est l’unité d’un corps, d’une âme et d’un esprit, porteur d’une vocation singulière. Dans la religion chrétienne, l’homme est appelé à grandir moralement, grâce à ses efforts personnels pour croître en vertu, et spirituellement avec l’aide de la grâce divine (don surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur Salut). Cette vision de l’”homme augmenté” conduit à une considération du salut très différente de ce que propose la foi chrétienne.
L’autosuffisance ou la fausse promesse de salut
L’une des grandes promesses du transhumanisme est de vaincre la mort en garantissant une forme d’immortalité biologique. Cette quête repose sur l’idée que la technologie peut résoudre tous les maux humains (la souffrance, le vieillissement, la mort) et ainsi permettre à l’homme de se sauver lui-même. Pour la foi chrétienne, le salut ne vient pas d’un dépassement technique de l’Homme, mais de la rédemption par le Christ qui s’est incarné et qui est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. La souffrance, loin d’être absurde, peut alors devenir un chemin de croissance spirituelle et d’union à Dieu. La mort, elle-même, n’est pas niée, mais traversée et vaincue par la résurrection du Christ. En refusant la dimension spirituelle du salut, le transhumanisme réduit la vie humaine à une suite d’améliorations matérielles et occulte la profondeur existentielle du cœur humain.
Un effacement de la transcendance et du rôle de Dieu
Dans le discours transhumaniste, l’homme n’a plus besoin de Dieu. Il devient lui-même créateur, maître du vivant, forgeant sa propre évolution. Cette volonté de toute-puissance renoue avec la tentation originelle décrite dans la Genèse, lorsque le serpent tenta Eve en disant : “vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal” (Genèse 3, 5). Il ne s’agit plus de se recevoir comme créature, mais de s’inventer soi-même sans limites, selon ses propres désirs. La foi chrétienne, au contraire, repose sur l’accueil de la vie comme un don, et sur la reconnaissance d’un Dieu créateur, Père aimant, source de tout être. L’homme trouve son accomplissement non dans l’auto-affirmation illimitée, mais dans la relation d’amour avec Dieu et avec autrui.
Vous avez soif d’absolu ? Cultivez votre relation à Dieu avec la méditation chrétienne !
Meditatio, première application de méditation chrétienne francophone, propose de nombreux programmes de méditations audioguidées sur des thématiques variées. Retrouvez notamment notre “Parcours découverte” de la méditation chrétienne, directement sur notre application.
- https://fr.aleteia.org/2020/06/23/pourquoi-le-transhumanisme-est-il-dangereux/
- https://fr.aleteia.org/2018/04/26/lhomme-biblique-face-aux-defis-du-transhumanisme/
- “Demain les post-humains”, Jean-Michel Besnier, éditions Fayard