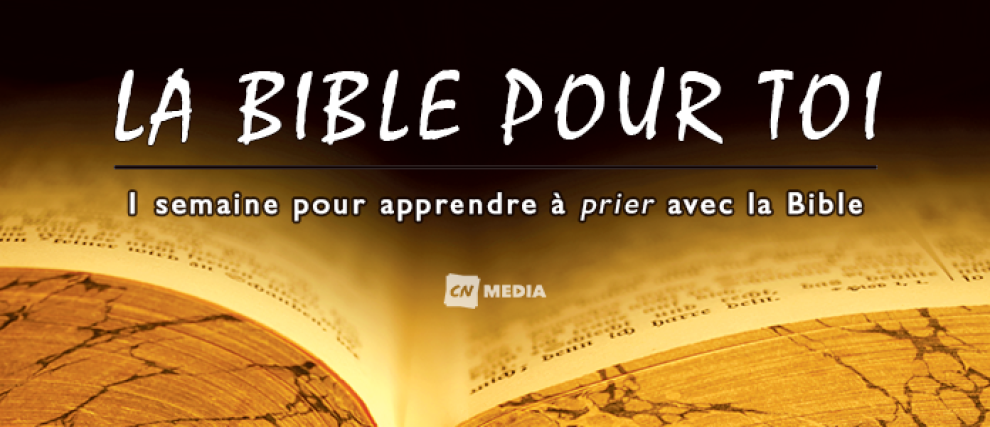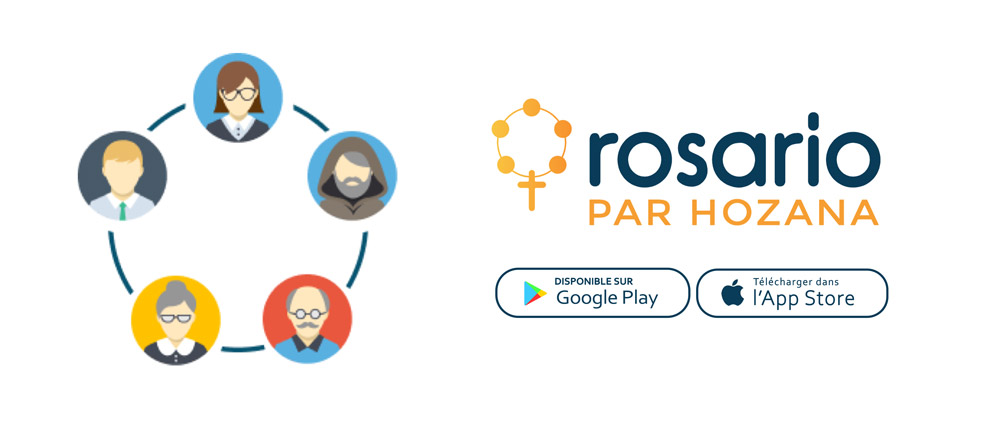Le marcionisme : une hérésie qui tente de séparer l'ancien et le nouveau testament
Le marcionisme apparaît au cœur du IIᵉ siècle comme l’une des premières grandes hérésies de l’Église naissante. Marcion, homme ascétique venu du Pont (aujourd'hui dans le nord de la Turquie, sur les bords de la mer noire), croyait servir la pureté de l’Évangile en opposant radicalement le Dieu de l’Ancien Testament, qu’il jugeait sévère et justicier, au Dieu de miséricorde révélé par Jésus-Christ. Convaincu qu’il existait deux divinités étrangères l’une à l’autre, il veut « purifier » la foi chrétienne en rejetant tout l’héritage biblique d’Israël et en ne conservant qu’une version abrégée de l’Évangile de Luc, ainsi que certaines lettres de saint Paul retouchées selon ses vues.
Mais en séparant l’Ancien et le Nouveau Testament, Marcion rompait l’unité profonde de la révélation. Il méconnaissait le dessein d’amour qui traverse toute l’Écriture comme un seul fleuve : le Dieu qui crée est aussi celui qui sauve ; le Dieu qui parle à Moïse est le même qui se fait chair dans le Christ. Il est Dieu trinitaire. Contre cette déchirure, l’Église affirme avec force l’unité du Dieu unique et l’harmonie intérieure de la Bible, où loi et grâce, justice et miséricorde ne s’opposent pas, mais s’éclairent.
Considéré comme hérétique dès 144, le marcionisme révèle l’importance vitale de confesser une seule dispensiation du salut, un seul Dieu et une seule histoire sainte. Il demeure, à travers les siècles, un rappel discret mais permanent : toute lecture qui oppose l’Écriture à elle-même finit par perdre la vérité de l’amour divin qui s’y déploie.
Origines et émergence du Marcionisme
Marcion naît vers la fin du Ier siècle, dans la cité portuaire de Sinope, au bord de la mer Noire. Issu d’une communauté chrétienne déjà formée, il reçoit une éducation religieuse solide. De tempérament grave et exigeant, il adopte très tôt une vie ascétique, recherchant la pureté dans la simplicité : maîtrise du corps, sobriété dans les biens, détachement du monde. Rien en lui n’annonce un rebelle, mais plutôt un homme sincèrement à la recherche de Dieu, habité par le désir ardent de fidélité à l’Évangile.
Lorsqu’il arrive à Rome, vers 140, Marcion est déjà un homme reconnu pour son austérité et sa générosité. Il offre une somme considérable à l’Église romaine pour soutenir son œuvre, signe de son engagement sérieux. Mais très vite, un trouble s’insinue dans son intelligence de la foi. Marcion est profondément frappé par le contraste qu’il croit voir entre, d’une part, la justice exigeante et parfois redoutable de Dieu dans l’Ancien Testament, et d’autre part, la tendresse infinie du Père révélée par Jésus-Christ. Il ne parvient pas à concilier ces deux visages de Dieu et, là où l’Église discerne l’unité d’un même dessein d’amour, lui perçoit une fracture irréductible.
Ainsi, c’est moins l’esprit de révolte que l’incompréhension spirituelle qui ouvre la voie au marcionisme. Comme si, devant l’immensité du mystère divin, Marcion avait voulu simplifier ce qui ne peut l’être, trancher là où il aurait fallu méditer, distinguer sans jamais diviser. C’est de cette tension, sincère mais douloureuse, que naît l’erreur qui portera son nom.
Doctrine et enseignement de Marcion
Peu à peu, la réflexion de Marcion s’organise autour d’une conviction radicale : il existerait deux dieux. Le premier, celui de l’Ancien Testament, serait un dieu créateur, mais sévère, un démiurge légaliste et inflexible, maître du monde matériel et juge implacable des hommes. Le second, révélé par Jésus-Christ, serait le Dieu bon, Dieu de miséricorde et de pardon, étranger à toute violence, à toute exigence, à toute Loi. Marcion voit dans l’Évangile la rupture absolue avec l’ancienne alliance et non son accomplissement.
Pour donner forme à cette vision, il en arrive à rejeter en bloc l’Ancien Testament, qu’il considère comme falsifié par un dieu inférieur. Mais il ne s’arrête pas là : il rejette la naissance du Christ par la Vierge Marie et nie tout lien avec le judaïsme. Persuadé que même l’Évangile avait été altéré par une influence « judaïsante », Marcion élabore son propre canon des Écritures. Il conserve un Évangile apparenté à celui de Luc, mais dépouillé de tout ce qui évoque les prophéties ou la continuité avec Israël. À cela, il ajoute dix lettres de saint Paul, lui aussi expurgé et réinterprété, car Paul lui apparaît comme l’apôtre authentique de la grâce pure, affranchie de la Loi. Mais sa rupture ne concerne pas seulement l’Écriture : elle touche la compréhension même du monde. Pour lui, la création matérielle n’est pas bonne ; elle est le fruit d’un dieu inférieur, imparfait, voire injuste. La matière devient suspecte, la chair une prison. En ce sens, il se rapproche du gnosticisme. Là où la foi chrétienne proclame que « le Verbe s’est fait chair » pour sauver l’homme dans ce qu’il est, Marcion veut libérer l’homme de la chair elle-même.
De cette vision naît un rigorisme radical. Marcion rejette le mariage, la fécondité, et jusqu’aux liens les plus simples avec la terre. La vie chrétienne devient ascèse de séparation, détachement absolu de tout ce qui est humainement donné. La création n’est plus un don, mais un piège.
Cette méfiance envers la matière conduit Marcion à nier la réalité de l’Incarnation. Le Christ, dit-il, n’a pas vraiment assumé notre chair : il n’a fait que « paraître » homme. C’est le docétisme (du grec dokein, « sembler, apparaître ») : le Fils n’aurait traversé notre monde qu’en apparence, sans partager réellement notre condition.
Au cœur du marcionisme se trouve ainsi une rupture : rupture entre Création et Salut, entre Loi et Évangile, entre l’histoire de l’Alliance et la révélation de l’Amour, et aussi déni de l’annonce de Jésus par les prophètes. Cependant, en voulant purifier le message chrétien, Marcion le déracine. En séparant le Christ d’Israël, il sépare l’amour de la justice, la miséricorde de la fidélité, et s’éloigne ainsi de la cohérence profonde de la Révélation, qui est toujours l’œuvre d’un seul Dieu, patient, créateur et sauveur.
Réaction de l’Église et condamnation
L’Église ne tarde pas à percevoir la gravité de la rupture opérée par Marcion. Car si l’on sépare le Dieu créateur du Dieu sauveur, si l’on oppose la justice à la miséricorde, alors c’est l’unité même du mystère chrétien qui se trouve brisée. Dès les années 140-144, les évêques de Rome l’interrogent et l’invitent à revenir à la foi reçue des apôtres. Mais Marcion persiste : pour lui, l’Évangile est délivrance absolue de la Loi, au point qu’il ne peut concevoir que le Dieu qui parle à Moïse soit le même que celui que Jésus appelle « Père ».
Face à cette fracture, les Pères de l’Église s’insurgent. Saint Justin de Rome défend l’accomplissement des Écritures dans le Christ. Saint Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies, affirme avec force l’unité du dessein de Dieu à travers l’histoire. Tertullien, dans Contre Marcion, démonte patiemment l’illusion d’un Évangile sans racines. Tous proclament d’une seule voix : « Il n’y a qu’un seul Dieu, créateur et sauveur, fidèle d’âge en âge. »
Vers 144, Marcion est excommunié par l’Église de Rome. Sa communauté se sépare alors et continue d’exister pendant plusieurs siècles, formant une Église parallèle. Cette crise, douloureuse mais décisive, conduit l’Église à affermir le canon des Écritures : c’est en réponse au marcionisme que se précise la liste des livres reconnus comme inspirés, où Ancien et Nouveau Testament s’éclairent mutuellement.
Ainsi, ce qui fut condamné ne fut pas la quête de pureté, mais la rupture de l’unité. Car la vérité chrétienne n’est pas la grâce sans la justice, ni l’amour sans la fidélité : elle est l’unique dessein de Dieu, qui se déploie patiemment dans l’histoire pour sauver l’homme.
Héritage et résonances contemporaines
Si le marcionisme disparaît progressivement au cours des premiers siècles, son intuition blessée traverse l’histoire et ressurgit sous des formes subtiles. La tentation demeure, aujourd’hui encore, de séparer l’Ancien et le Nouveau Testament, de ne retenir du Christ que la douceur de ses paroles en rejetant la mémoire d’Israël, ses psaumes, ses prophètes, ses appels à la justice. On entend parfois affirmer : “ Le Dieu de l’Ancien Testament serait sévère ; celui du Nouveau serait amour.” Cette opposition, pourtant, est étrangère à la foi de l’Église. Elle trahit l’unité de la Révélation, où le Dieu qui crée est le même que celui qui sauve, où la Loi prépare la Grâce, où la promesse trouve son accomplissement dans le Christ.
Comme le soulignent certains philosophes sur le « monde moderne », notre époque porte parfois en elle un néo-marcionisme diffus : désir d’un Dieu purement consolateur, refus du tragique, méfiance envers la chair considérée comme lourde, pesante, imparfaite. Là où le christianisme confesse la bonté du monde créé, le marcionisme ancien comme moderne soupçonne la matière. Là où la foi voit une histoire du salut traversant les âges, le marcionisme rêve d’une rupture, d’un commencement sans héritage. Le modernisme serait une forme de “marcionisme actualisé” : un homme qui ne veut plus recevoir sa vie comme un don, mais la fabriquer seul, à partir de lui-même, coupé de la mémoire sacrée.
L’Église rappelle l’unité profonde de l’Ecriture, l’unité de la Révélation, unité du dessein divin. L’Ancien et le Nouveau Testament ne se contredisent pas : ils se répondent, ils s’annoncent, ils se portent l’un l’autre. Ensemble, ils racontent l’histoire d’un Dieu fidèle, qui ne cesse de venir à la rencontre de son peuple, jusqu’à se donner tout entier en Jésus-Christ. D’ailleurs, le Catéchisme de l’Église catholique rappelle que les deux testaments sont inséparables dans le § 129 : “le Nouveau testament est caché dans l’Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau” (Saint Augustin). De même : “La Loi nouvelle accomplit, affine, dépasse et porte à sa perfection la Loi ancienne”. (CEC § 1968)
Avec Hozana, faites grandir chaque jour votre foi !
Sur Hozana, entrez dans la vie des communautés de prière, où la ferveur se transmet et où la foi se ravive ; partagez des instants d’intériorité qui vous aident à redécouvrir, à nourrir et à faire grandir votre relation au Christ, pas à pas, au quotidien !
Comme, par exemple :
cette pour plonger dans le Credo, racine de la foi catholique.
ce parcours pour approfondir ses connaissances de .
ou encore ces .