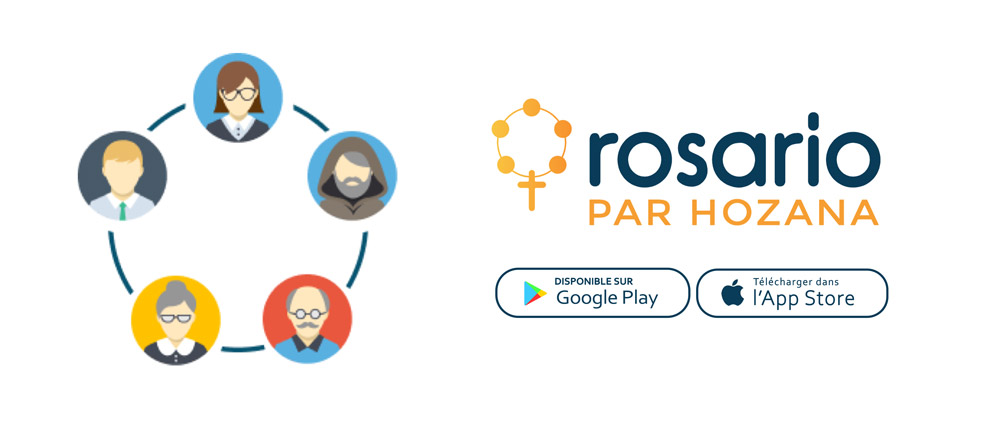Le nestorianisme : l'hérésie qui divisait la nature du Christ
Au Ve siècle, l’Église traverse l’une des plus profondes crises de sa foi naissante. Après avoir confessé, contre Arius, la pleine divinité du Fils, elle se voit à nouveau secouée par une hérésie, concernant cette fois l’union du divin et de l’humain dans le Christ. C’est là que s’élève la figure de Nestorius, moine d’Antioche devenu patriarche de Constantinople, dont la pensée, soucieuse de préserver la transcendance de Dieu, finira par diviser le mystère du Christ lui-même.
Nestorius sépare si nettement les deux natures, qu’il en vient à parler non d’un seul Christ, Dieu et homme, mais de deux personnes unies seulement par la volonté. De là naît son refus du titre de Marie, Mère de Dieu (Theotokos), qu’il juge contraire à la raison : comment une femme pourrait-elle enfanter Dieu ?
Cette affirmation soulève une tempête. L’Eglise d’Alexandrie s’oppose vigoureusement à Nestorius, défendant au contraire l’unité du mystère de l’Incarnation. La controverse se propage dans tout l’Empire, jusqu’à ce que l’Église, réunie au concile d’Éphèse en 431, tranche le débat et proclame solennellement le Christ une seule personne en deux natures, et Marie, mère de Dieu.
Ainsi, le nestorianisme apparaît aussi comme une étape nécessaire : en cherchant maladroitement à défendre la pureté du divin, il oblige l’Église à préciser avec plus de lumière encore le mystère de l’union de Dieu et de l’homme dans le Christ.
Origines et contexte du Nestorianisme
Le nestorianisme s’enracine dans le climat du Ve siècle, où l’Église poursuit avec ardeur la clarification du mystère du Christ. Deux grandes écoles dominent alors la réflexion : l’école d’Alexandrie, qui insiste sur l’unité profonde du Verbe incarné, et l’école d’Antioche, soucieuse de préserver la distinction entre l’humanité et la divinité de Jésus.
C’est dans cet univers intellectuel, traversé par des débats passionnés sur l’Incarnation, que prend forme la pensée qui sera associée à Nestorius. Originaire des régions d’Antioche, il appartient à cette tradition qui refuse toute confusion entre les natures du Christ. Lorsqu’il est appelé en 428 à occuper le siège prestigieux de Constantinople, ces sensibilités théologiques se trouvent soudain portées au premier plan de l’Église impériale.
Les tensions entre les écoles théologiques, déjà vives, s’exacerbent. Alexandrie et Antioche, chacune à sa manière, défendent l’intégrité du mystère chrétien : l’une en soulignant l’unité du Christ, l’autre en respectant la distinction des deux natures.
Ainsi, le nestorianisme apparaît comme l’aboutissement d’un long débat sur la manière de comprendre le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Cette controverse s’inscrit dans une période où l’Église, après avoir affirmé la divinité du Fils face à l’arianisme, cherche désormais à exprimer avec justesse l’union du divin et de l’humain dans la personne unique du Sauveur.
La doctrine de Nestorius et la controverse mariale
Formé par la tradition antiochienne, Nestorius cherche à préserver la plénitude de l’humanité de Jésus, et refuse qu’elle soit absorbée dans la splendeur de sa divinité. Pour lui, il faut maintenir avec clarté la distinction entre les deux natures. Mais cette vigilance le conduit à souligner une séparation trop rigide où l’union du Verbe et de l’homme Jésus apparaît comme un lien moral plutôt qu’une véritable unité personnelle.
Cette position se manifeste publiquement lorsqu’il remet en question le titre de Marie, Theotokos, « Mère de Dieu », largement reçu dans la tradition chrétienne. Nestorius craint que ce titre n’implique que la divinité elle-même ait été engendrée. Il préfère parler de Marie, Christotokos, « Mère du Christ », estimant que cette expression préserve mieux la distinction entre le Verbe éternel et l’homme né dans le temps.
Cependant, cette réserve soulève une inquiétude profonde dans l’Église. Si Marie n’est mère que de l’homme Jésus, comment affirmer que celui qui naît, qui parle, qui souffre et qui meurt est vraiment une seule et même personne, Dieu fait homme ? La foi chrétienne risque alors de se trouver divisée entre un Dieu qui demeure à distance et un homme qui assume seul la souffrance.
Face à cette dérive, l’école d’Alexandrie, portée par Cyrille d’Alexandrie, affirme avec force l’unité du Christ : celui qui naît de Marie est bien le Verbe incarné. Le titre de Theotokos ne signifie pas que Marie donne l’existence à la divinité, mais qu’elle met au monde la personne unique du Fils, véritablement Dieu et véritablement homme.
Ainsi, le débat marial révèle le cœur du problème. Le nestorianisme, en séparant trop les natures, en vient à fragiliser l’unité du Sauveur et, par là même, la réalité du salut.
La condamnation du nestorianisme et ses suites
La controverse, d’abord limitée à Constantinople, se propage rapidement à l’ensemble de l’Empire. L’empereur Théodose II, soucieux de préserver l’unité de l’Église et la paix civile, convoque en 431 un concile œcuménique dans la cité d’Éphèse.
Sous l’influence déterminante de Cyrille d’Alexandrie, le concile affirme avec force que le Christ n’est pas deux sujets unis par une coopération morale, mais une seule personne dans laquelle demeurent pleinement les deux natures, divine et humaine. En conséquence, le concile confirme la légitimité du titre de Marie, Theotokos, Mère de Dieu, car celui qu’elle enfante est la personne unique du Fils incarné. La formule n’est pas seulement un hommage à la Vierge ; elle devient la clef qui garantit l’unité du mystère du Christ.
Nestorius est déposé de son siège puis exilé, sans pour autant renoncer entièrement à sa compréhension du Christ. Ses partisans se regroupent peu à peu en Orient, notamment en Perse, où ils trouvent un terrain favorable pour développer une tradition théologique distincte.
La controverse ne s’apaise définitivement qu’au concile de Chalcédoine en 451, qui approfondit la doctrine de l’Incarnation : le Christ est confessé une seule personne en deux natures, « sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation ».
Ainsi, en cherchant à protéger le mystère de l’humanité du Christ, cette doctrine oblige l’Église à préciser davantage encore la lumière de l’Incarnation, et à confesser avec une clarté nouvelle la splendeur du Dieu fait homme.
Héritage et traces du nestorianisme
Bien que condamné par l’Église au Ve siècle, le nestorianisme ne disparaît pas aussitôt. Chassés de l’Empire romain, plusieurs disciples nestoriens trouvent refuge en Perse, où se structure progressivement ce que l’on appellera l’Église d’Orient. Cette Église se déploie en Mésopotamie, Arabie, puis en Inde, et jusqu’en Chine où, dès le VIIIᵉ siècle, des stèles gravées témoignent de la présence chrétienne nestorienne.
Si ces communautés ne se reconnaissent pas nécessairement dans toutes les formulations de Nestorius, elles en héritent une manière particulière de comprendre le mystère du Christ, marquée par l’accent sur la distinction des natures et sur l’humanité pleinement assumée par le Sauveur.
En clarifiant l’union du divin et de l’humain dans le Christ, le concile d’Éphèse puis celui de Chalcédoine ont offert une formulation équilibrée du mystère chrétien, qui protège à la fois la vérité de l’Incarnation et la réalité de la rédemption.
Malgré les blessures du passé, un dialogue œcuménique s’est engagé au XXᵉ siècle entre l’Église catholique (saint Jean Paul II) et les héritiers de l’ancienne Église d’Orient. Bien des oppositions relevaient davantage du langage que de divergences doctrinales irréductibles.
Avec Hozana, faites grandir chaque jour votre foi !
Sur Hozana, plongez au cœur de communautés de prières vivantes et partagez des moments spirituels qui vous aident à redécouvrir, nourrir et approfondir votre foi au quotidien !
Comme, par exemple :
cette pour l’unité de l’Eglise
cette neuvaine avec Marie pour
ou encore cette neuvaine pour avec Sainte Thérèse de Lisieux