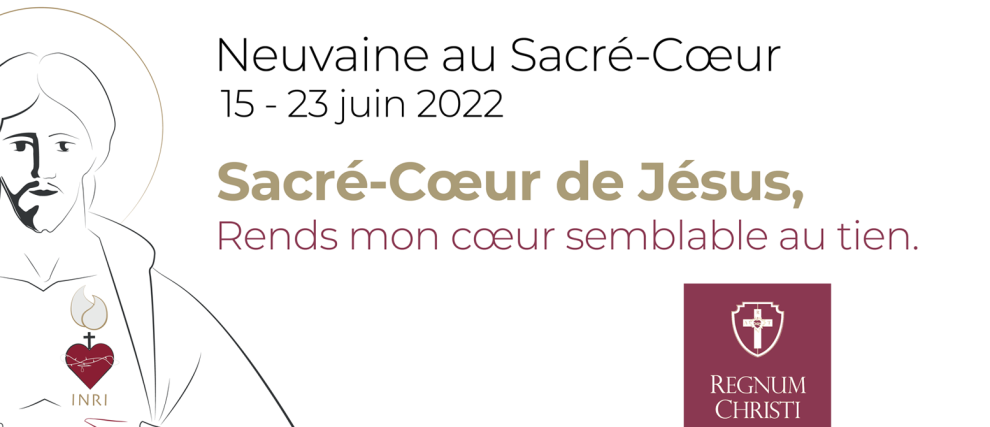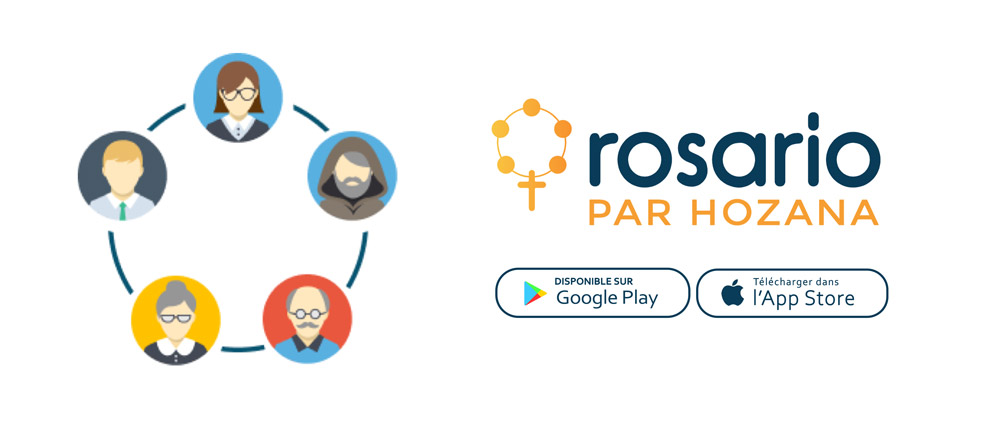Les hérésies dans l’Église catholique
Le mot hérésie, du grec haíresis (choix, école de pensée), désigne dans le christianisme une doctrine ou une interprétation qui s’écarte de la foi reconnue comme authentique par l’Église. Au fil des siècles, nombre de courants, souvent nés d’une recherche sincère de vérité, ont été déclarés hérétiques lorsqu’ils mettaient en péril l’unité de la foi ou la compréhension du mystère du Christ. Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, l'hérésie est définie comme la « négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » (§ 2089 du Catéchisme de l'Église catholique). Autrement dit, il s’agit d’une doctrine ou d’une opinion contraire à l’enseignement officiel de l’Église catholique. Celui qui soutient une hérésie est qualifié d’hérétique. Le Code de droit canonique prévoit des sanctions comme l’excommunication automatique en cas d’hérésie (Can. 1364). Dans cet article, découvrez les principales hérésies dans l’histoire de l’Église catholique et comment s’en prémunir aujourd’hui.
Les hérésies concernant Jésus-Christ
Découvrez ci-dessous les principales hérésies concernant Jésus-Christ, appelées hérésies christologiques.
Le gnosticisme
Le gnosticisme, né aux premiers siècles du christianisme, fut l’une des plus anciennes hérésies. Il reposait sur l’idée que le salut ne venait pas de la foi ou des œuvres, mais d’une gnose, une connaissance secrète réservée à quelques initiés. Selon cette vision, le monde matériel, œuvre d’un démiurge inférieur, était mauvais ; seule l’âme, étincelle divine prisonnière de la chair, aspirait à retrouver la lumière du vrai Dieu, inconnu et lointain. Cette cosmologie dualiste, où s’opposent esprit et matière, lumière et ténèbres, séduisit nombre d’esprits épris d’absolu, mais fut rejetée dès le IIᵉ siècle par les Pères de l’Église, notamment Irénée de Lyon et Tertullien, qui affirmèrent la bonté de la création et la réalité de l’incarnation. Le gnosticisme apparaît comme le symbole d’une quête mystique égarée, où le désir de connaître Dieu finit par séparer l’homme de Lui.
Le marcionisme
Le marcionisme, né au IIᵉ siècle autour de Marcion de Sinope, prêchait une rupture radicale entre le Dieu de l’Ancien Testament et celui de l’Évangile. Le premier, juge sévère et créateur du monde matériel, était pour lui un démiurge inférieur ; le second, Dieu de miséricorde révélé par le Christ, incarnait l’amour pur et la délivrance. Marcion rejeta donc tout l’Ancien Testament et composa son propre canon, réduit à un Évangile de Luc épuré et à quelques lettres de Paul. L’Église condamne solennellement sa doctrine vers 144 à Rome, voyant dans cette séparation un péril mortel pour la foi : elle réaffirme alors l’unité de Dieu, la continuité de la révélation et la valeur spirituelle de l’Ancien Testament. Le marcionisme, en opposant justice et miséricorde, loi et grâce, pose toujours la question prégnante de savoir comment concilier la rigueur du Dieu créateur avec la tendresse infinie du Dieu Sauveur.
L’arianisme
Né au début du IVᵉ siècle sous l’impulsion du prêtre Arius d’Alexandrie, l'arianisme fut l’une des hérésies les plus graves de l’histoire chrétienne. Elle enseignait que le Fils, bien qu’exalté au-dessus de toute créature, n’était pas Dieu au même titre que le Père : créé avant les temps, il aurait eu un commencement et ne serait donc pas éternel. Cette doctrine menaçait le cœur même du christianisme : si le Christ n’est pas Dieu, comment pourrait-il sauver l’homme ? Devant la gravité du trouble, l’empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en 325, où plus de trois cents évêques proclamèrent la consubstantialité du Fils avec le Père : homoousios tō Patri, « de même nature que le Père ». Le concile de Nicée affirme alors que le Fils est « engendré, non pas créé », scellant le rejet de l’arianisme, confirmé par le concile de Constantinople en 381, qui étendit la confession à l’Esprit Saint, ce qui signifie qu’il a ajouté au Credo, déjà formulé à Nicée, une clause qui reconnaît explicitement la divinité et la place du Saint‑Esprit au sein de la Trinité. L’arianisme s’éteint peu à peu, laissant à l’Église la lumière du mystère central de la Trinité.
Citons un extrait du Catéchisme de l’Église catholique (§465) :
« Le premier Concile œcuménique de Nicée,(...) condamna Arius qui affirmait que « le Fils de Dieu est sorti du néant » et qu'il serait « d'une autre substance que le Père » »
L’apollinarisme
L’apollinarisme, né dans la seconde moitié du IVᵉ siècle, doit son nom à Apollinaire de Laodicée, évêque cultivé et disciple fidèle d’Athanase d’Alexandrie. Désireux de défendre la divinité du Christ contre l’arianisme, il alla cependant trop loin en niant la plénitude de son humanité. Selon lui, le Verbe divin avait pris corps, mais non pas une âme raisonnable : Ainsi, le Christ n’aurait pas été pleinement homme, mais une chair animée directement par la divinité. L’intention d’Apollinaire était de préserver l’unité du Christ, mais sa doctrine menaçait le mystère de l’incarnation, car ce qui n’est pas assumé ne peut être sauvé, selon la formule de saint Grégoire de Nazianze.
L’Église condamne solennellement l’apollinarisme d’abord au concile d’Alexandrie en 362, puis surtout au concile de Constantinople en 381, où fut réaffirmée la pleine humanité du Christ : esprit, âme et corps unis sans confusion à la nature divine dans une seule et même personne. Cette décision scella la foi en un Sauveur à la fois vrai Dieu et vrai homme, capable de relever toute la nature humaine par la puissance de sa divinité et la vérité de son humanité.
Le nestorianisme
Le nestorianisme, apparu au début du Vᵉ siècle, prit forme sous l’influence de Nestorius, patriarche de Constantinople. Soucieux de préserver la distinction entre la nature divine et la nature humaine du Christ, il en vint à les séparer à l’excès, parlant de deux personnes unies moralement plutôt que d’une seule personne véritablement divine et humaine. Dès lors, il refusa d’appeler la Vierge Marie Théotokos, « Mère de Dieu », estimant qu’elle n’avait enfanté que l’homme Jésus, non le Verbe éternel. Cette division du Christ scandalise les fidèles et trouble profondément l’unité de la foi. L’Église réagit avec vigueur : le concile d’Éphèse, réuni en 431 sous l’autorité de saint Cyrille d’Alexandrie, condamne le nestorianisme et proclame que le Christ est une seule personne en deux natures, et que Marie peut être dite véritablement Mère de Dieu, puisqu’elle a porté dans sa chair le Verbe incarné.
Il est à noter cependant qu’une partie de la tradition nestorienne perdure encore aujourd’hui au sein de l’Église assyrienne de l’Orient, qui a conservé la distinction entre les deux natures du Christ. Cette Église, centrée historiquement en Mésopotamie et étendue jusqu’en Inde et en Chine, se considère fidèle à cette interprétation de l’incarnation, et se distingue donc de celle adoptée par l’Église universelle.
Citons ci-dessous un extrait du Catéchisme de l’Église catholique (§466) :
“L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qui l'a assumée et faite sienne dès sa conception. Pour cela le Concile d'Ephèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité Mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein”
Le monophysisme
Le monophysisme, dont le nom vient du grec monê physis — « une seule nature » —, apparait au Vᵉ siècle comme une réaction excessive contre le nestorianisme. Ses partisans, à la suite de l’archimandrite Eutychès, affirment qu’après l’incarnation, la nature humaine du Christ s’est comme fondue dans la nature divine, ne formant plus qu’une seule nature, essentiellement divine. Ainsi, le Christ n’aurait été qu’apparemment homme, et son humanité, absorbée par la divinité, perdait toute réalité propre.
L’Église condamne cette doctrine au concile de Chalcédoine en 451, quatrième concile œcuménique, qui proclame la foi « en un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation ». Par cette formule d’équilibre, l’Église affirme la vérité centrale de l’incarnation : le Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, unis en une seule personne pour le salut du monde.
Citons un extrait du Catéchisme de l’Église catholique (§467):
« Un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase ».
Les hérésies liées à la grâce et au salut
Le manichéisme
Le manichéisme, né au IIIᵉ siècle sous l’impulsion du prophète perse Mani, proposait une vision du monde fondée sur un dualisme absolu. Selon cette doctrine, l’univers était le théâtre d’un combat éternel entre deux principes égaux et contraires : la Lumière, source du Bien, et les Ténèbres, principe du Mal. L’âme humaine, étincelle de lumière captive dans la matière, devait se purifier pour retourner vers le royaume spirituel. Ce système, nourri d’influences chrétiennes, zoroastriennes et gnostiques, séduisit de nombreux esprits en quête de pureté, dont le jeune saint Augustin avant sa conversion. L’Église condamne le manichéisme dès le IVᵉ siècle, notamment lors du concile d’Arles en 314, affirmant contre lui la bonté de la création et l’unicité du Dieu créateur. Cette hérésie, par son exigence de pureté absolue, met en évidence un danger permanent : nier le rôle du corps dans le salut de l’homme et rejeter le mystère de l’incarnation.
Le pélagianisme
Le pélagianisme, né au début du Vᵉ siècle autour du moine britannique Pélage, prônait une vision exaltée de la liberté humaine. Refusant l’idée du péché originel, Pélage affirmait que l’homme pouvait, par sa seule volonté et par l’imitation du Christ, atteindre la perfection morale et le salut. La grâce divine n’était pour lui qu’un secours extérieur, et non une force intérieure transformant l’âme. Cette doctrine séduit par son optimisme, mais elle réduisait la rédemption à un effort humain, niant la nécessité de la grâce rédemptrice. L’Église réagit avec fermeté : le concile de Carthage en 418, soutenu par saint Augustin, condamna le pélagianisme et proclame que la grâce est absolument indispensable au salut, car c’est Dieu seul qui, par son amour, guérit la liberté blessée de l’homme.
Le semi-pélagianisme, né peu après en Provence, tente de concilier les positions extrêmes. Ses partisans, tels que Jean Cassien, reconnaissaient la grâce, mais affirmaient que le premier mouvement vers Dieu pourrait venir de la volonté humaine. Cette nuance, apparemment modérée, restait incompatible avec la doctrine augustinienne de la primauté de la grâce. Le concile d’Orange en 529, sous l’influence de saint Césaire d’Arles, condamne à son tour le semi-pélagianisme et réaffirma que toute conversion, tout bien spirituel, procède d’abord du don gratuit de Dieu. Ainsi fut scellée la foi de l’Église en la grâce prévenante, source et origine de tout salut.
Ici un extrait du CEC, §1998 : Le don de la grâce « surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine ».
Et aussi, dans Gaudete et exsultate, exhortation apostolique du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel : « on dit que nous sommes « justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de la justification. En effet, si c’est une grâce, elle ne vient pas des œuvres ; autrement, la grâce n’est plus la grâce »
Le catharisme
Le catharisme, né entre les XIᵉ et XIIIᵉ siècles dans le sud de la France, surtout en Languedoc, proposait une vision du monde profondément dualiste. Héritier du manichéisme, il opposait le Dieu du Bien, pur esprit, au Dieu du Mal, créateur du monde matériel. La chair, la naissance et la mort étaient perçues comme l’œuvre du Mal, et le salut consistait à libérer l’âme de sa prison corporelle par une vie d’ascèse et de renoncement. Les Parfaits, élite spirituelle du mouvement, prêchent la pauvreté, la chasteté et le refus des sacrements de l’Église, jugée corrompue et mondaine. L’Église condamne solennellement le catharisme au concile de Latran III en 1179, puis au concile de Latran IV en 1215, et lance la croisade contre les Albigeois pour l’éradiquer. De cette hérésie, qui alliait ferveur spirituelle et rejet du monde, demeure le souvenir d’une soif tragique de pureté, brûlante jusqu’à l’illusion.
Le vaudisme
Le vaudisme, né à Lyon vers 1170, prend sa source dans la conversion bouleversante de Pierre Valdo, riche marchand qui renonce à ses biens pour vivre selon l’Évangile à la manière des apôtres. Entouré de disciples appelés les Pauvres de Lyon, il prêchait la pauvreté radicale un peu comme saint François d’Assise, la simplicité évangélique et l’annonce directe de la Parole de Dieu, traduite en langue vernaculaire. Ce mouvement, d’abord animé d’un profond élan de foi, entre rapidement en conflit avec l’autorité ecclésiale à la différence des franciscains, car ses membres prêchaient sans mandat et contestaient la richesse du clergé. L’Église condamne le vaudisme au concile de Latran III en 1179, puis au concile de Vérone en 1184, le déclarant hérétique. Bien que pourchassés, les Vaudois persistent, préfigurant certaines intuitions de la Réforme. Leur histoire témoigne d’un désir ardent de fidélité à l’Évangile, mais d’une fidélité blessée, coupée de la communion ecclésiale.
Le jansénisme
Le jansénisme, apparu au XVIIᵉ siècle, prend son origine dans la pensée du théologien flamand Cornelius Jansen, évêque d’Ypres, dont l’ouvrage Augustinus (publié en 1640) développe une vision rigoriste de la grâce et de la prédestination. Les jansénistes insistaient sur la corruption du cœur humain par le péché originel et sur la nécessité d’une grâce divine irrésistible pour atteindre le salut, dénonçant ce qu’ils considéraient comme la mollesse morale et théologique des jésuites. Cette doctrine, qui suscite d’intenses débats sur la liberté humaine et la miséricorde de Dieu, est condamnée à plusieurs reprises par Rome, notamment par la bulle Cum occasione en 1653, ainsi que par la Constitution Apostolique « Unigenitus Dei filius », (le Fils unique engendré par Dieu). Elle fait l’objet d’une surveillance étroite de la part de l’Église jusqu’au XVIIIᵉ siècle. Le jansénisme, mêlant austérité morale et spiritualité profonde, laisse une empreinte durable sur la religiosité française, inspirant des mouvements de piété intérieure et de recherche de sainteté exigeante.
Les hérésies aujourd’hui
Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler d’hérésie contemporaine, on peut considérer les nouvelles formes de spiritualité du New Age comme des hérésies modernes, dans la mesure où elles mêlent des éléments issus de traditions très diverses en un syncrétisme parfois confus et profondément éloigné de la doctrine chrétienne. Parmi ces pratiques, la réincarnation, la croyance en la loi d’attraction, l’écologie spirituelle, le recours au chamanisme ou aux guides spirituels, révèlent une approche où le salut et le bonheur semblent dépendre de forces humaines ou cosmiques plutôt que de la grâce divine. À cela s’ajoutent le relativisme, qui réduit toute vérité à une perception subjective, et le rationalisme, qui tend à subordonner la connaissance à la seule raison humaine. De manière plus subtile, le développement personnel peut aussi s’inscrire dans cette dynamique, lorsqu’il replace l’homme au centre de sa propre rédemption (un peu comme le pélagianisme) et transforme la quête spirituelle en simple technique d’accomplissement individuel. Des hérésies historiques telles que le gnosticisme ou le manichéisme trouvent dans ces pratiques modernes un certain écho, par la valorisation d’un savoir secret ou d’une lutte cosmique entre forces opposées. Ces tendances, séduisantes par leur promesse de maîtrise et d’épanouissement, rappellent néanmoins l’exigence de distinguer la lumière de la foi authentique des éclats trompeurs d’une spiritualité mondaine et bricolée.
Avec Hozana, nourrissez chaque jour votre foi !
Sur Hozana, découvrez des communautés de prières pour redécouvrir ou approfondir votre foi !
Comme, par exemple :
- Cette pour renforcer votre relation à Dieu,
- Ou pour redécouvrir les fondements de notre foi à partir du Credo,
- Ou encore
- Catéchisme de l'Église catholique
- Gaudete et exsultate : Exhortation apostolique du Pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, 19 mars 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
- Encyclopedia Universalis
- https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/heresy-in-the-early-church-timeline
- https://www.thegospelcoalition.org/essay/christological-controversies-in-the-early-church