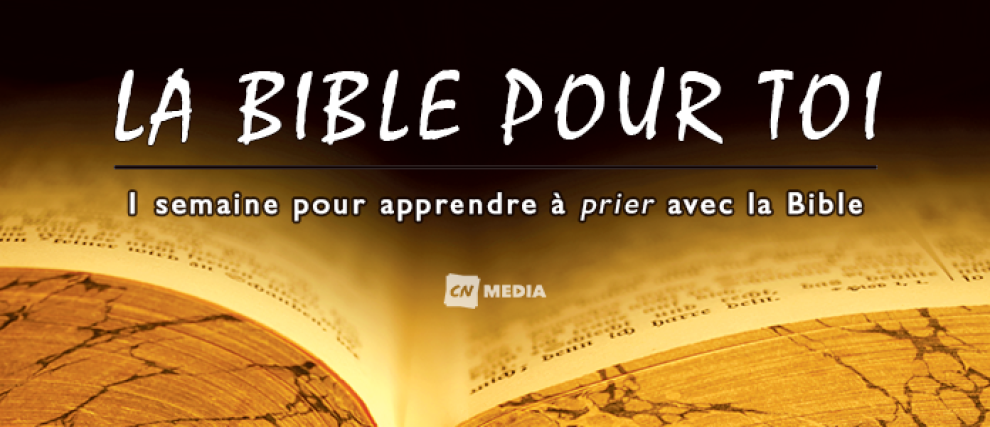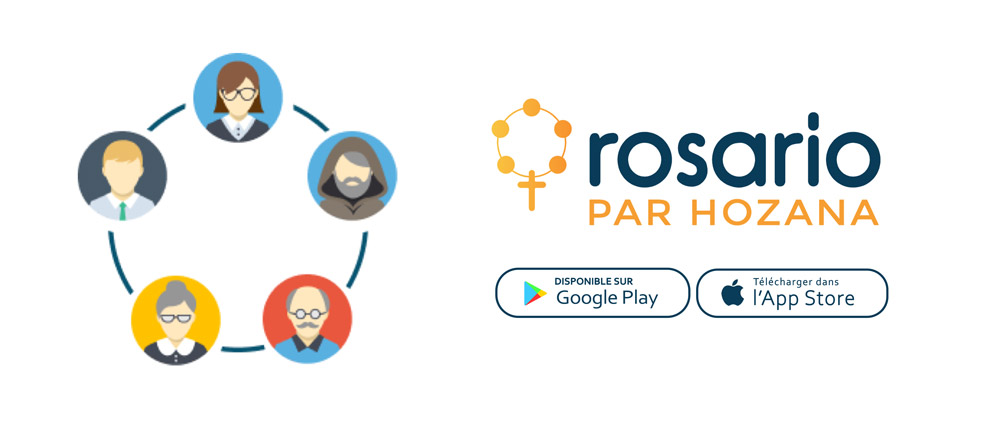Qui était Marcion ? L'homme qui voulait séparer l'Ancien du Nouveau Testament
/catechisme/questions-sur-la-foi/trinite/dieu-le-pereAu cœur des premiers siècles chrétiens, au moment où l’Église s’efforce encore de dire sa foi avec des mots justes, apparaît la figure singulière de Marcion de Sinope. On ne peut comprendre cet homme sans percevoir d’abord l’ardeur intérieure qui l’anime : une quête de pureté, une exigence spirituelle presque impitoyable envers lui-même comme envers le monde. Ardent partisan d’une ascèse stricte, attaché à la prière, fasciné par la bonté absolue de Dieu, mais profondément troublé par la présence du mal, de l’injustice et de la souffrance dans la création.
C’est cette tension intérieure, poussée jusqu’à l’extrême, qui le conduit, au IIᵉ siècle, à concevoir ce qui deviendra l’une des premières et des plus graves hérésies du christianisme : la séparation radicale entre le Dieu créateur de l’Ancien Testament et le Dieu révélé par le Christ. En voulant défendre la sainteté divine, Marcion en vient à déchirer l’unité de la Révélation, à rejeter la chair, la matière, l’histoire, jusqu’à nier l’Incarnation elle-même.
Son parcours est marqué par un excès de rigueur qui glisse hors de la vérité. Marcion est la figure d’un amour qui se trompe de chemin : un amour qui veut purifier Dieu au point d’oublier que Dieu s’est fait chair. En retraçant sa vie, ses choix, son itinéraire spirituel, nous découvrons non seulement l’origine du marcionisme, mais aussi une question toujours vivante : comment confesser un Dieu infiniment bon dans un monde marqué par la violence, le manque et la limite ?
Un homme de foi ascétique, venu des confins de l’Empire
Marcion naît vers la fin du Ier siècle, à Sinope, sur les rives de la mer Noire en Turquie actuelle. Le christianisme est encore jeune, reçu dans des communautés modestes, souvent marquées par une certaine sévérité morale, où l’Évangile s’unit volontiers à une ascèse rigoureuse. Son père est vraisemblablement un responsable de l’Église locale. Cependant les sources divergent sur ses origines et Tertullien (théologien du II et IIIè siècles) le classerait parmi les stoïciens ou les épicuriens. Marcion grandit dans un climat de discipline, de prière et d’exigence intérieure.
Dès sa jeunesse, il se distingue par une tempérance extrême, un goût prononcé pour l’ascèse et la radicalité dans l’effort spirituel. Il jeûne, il se prive, il veille. Son rapport au monde est empreint de gravité : il perçoit la chair comme lieu de faiblesse, la matière comme pesanteur, et porte en lui le désir d’un Dieu absolument pur.
Rien, à ce stade, ne le sépare encore de l’Église. Au contraire, il cherche à servir, à comprendre, à se donner. Mais cette ardeur ascétique, si elle n’est pas portée par l’humilité, peut devenir une impasse. Elle risque de transformer la foi en exigence intransigeante, la contemplation en suspicion, l’amour de Dieu en refus de la création de Dieu.
A Rome : reconnaissance, influence puis rupture
Vers l’an 140, Marcion quitte sa terre natale et gagne Rome, centre intellectuel et spirituel du christianisme naissant. Il y est d’abord accueilli avec bienveillance. Riche armateur, il prodigue à l’Eglise de Rome une certaine somme à l’attention des pauvres qui le fait remarquer, d’autant plus qu’il se distingue par son austérité, sa droiture. Peu à peu, il gagne estime et confiance. On reconnaît en lui un homme de prière, animé d’un réel amour pour le Christ.
Mais bientôt surgissent ses questionnements : comment concilier la bonté infinie du Dieu de l’Évangile avec les récits parfois sévères, terribles, de l’Ancien Testament ? Comment comprendre que celui qui pardonne aux pécheurs soit aussi celui qui châtie ? Marcion lit l’Écriture avec intransigeance : il tolère mal le mystère de la pédagogie divine, de ses lenteurs, de ses étapes. Là où l’Église voit une histoire de salut qui se déploie, il croit percevoir une contradiction, et ce malgré le passage de Matthieu 19, 8 : “c’est en raison de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes”, ce qui explique la dureté de la loi divine.
Les débats s’ouvrent et Marcion propose une lecture radicale : le Dieu de la création n’est pas le Père de Jésus-Christ. Les Écritures d’Israël ne pourraient donc pas annoncer l’Évangile : elles seraient l’œuvre d’un démiurge, un dieu de justice, strict et imparfait, tandis que le Dieu révélé par Jésus serait le Dieu de la pure miséricorde.
Cette vision introduit une fracture impossible : séparer les Écritures, séparer Dieu lui-même. Devant l’ampleur de la rupture, les évêques de Rome tentent encore d’éclairer Marcion mais il demeure ferme dans sa quête de pureté.
Vers 144, l’Église n’a d’autre choix que de le séparer de sa communion. Marcion quitte Rome accompagné de quelques disciples.
La fracture intérieure : un Dieu pur et un monde impur
Il faut comprendre que Marcion ne supporte pas le scandale du mal : la souffrance, la violence, l’injustice présentes dans le monde lui paraissent incompatibles avec la bonté infinie de Dieu. Plutôt que de reconnaître que l’histoire du salut s’inscrit dans la patience d’une pédagogie divine, il en vient à opposer radicalement deux principes, celui d’un Dieu créateur, sévère, attentif à la faute, à la transgression, au jugement ; et le Dieu de l’Évangile, pur amour, pur pardon, dépourvu de toute exigence.
Mais Marcion ne s’arrête pas là : il en arrive à penser que la création elle-même est mauvaise, qu’elle est le lieu de la chute. La chair devient suspecte, le mariage est refusé, la fécondité perçue comme une complicité avec la matière. L’homme doit, pour être sauvé, se détacher du monde, se désincarner, se dépouiller, presque se délier de lui-même.
Cette vision conduit naturellement Marcion à un docétisme profond : si la chair est impure, le Christ n’a pas pu vraiment l’assumer. Il n’a fait que paraître homme — un visage d’humanité, sans les larmes, sans la fatigue, sans la sueur, sans la croix véritable.
En refusant que la chair puisse devenir lieu de salut, Marcion refuse l’Incarnation elle-même. Et c’est là que sa quête d’absolu se renverse : en voulant purifier Dieu, il finit par le rendre étranger au monde qu’Il aime.
La condamnation et la trace laissée dans l’histoire
Après son départ de Rome, Marcion ne renonce pas à prêcher sa vision du christianisme. Des communautés se forment autour de lui, austères, ferventes, missionnaires même ; elles se répandent en Asie Mineure, en Syrie, jusqu’en Afrique du Nord. Le marcionisme, loin d’être une simple dissidence locale, devient alors un courant structuré, avec ses assemblées, sa liturgie, ses évangiles abrégés, ses règles de vie sévères.
Mais l’Église ne demeure pas silencieuse. Saint Justin, Saint Irénée et plus tard Tertullien s’emploient à répondre, non seulement à la doctrine, mais à l’angoisse spirituelle qui la sous-tend : comment confesser un Dieu unique, à la fois créateur et sauveur ? Comment reconnaître la bonté du monde, malgré la souffrance et la mort ?
Dans Contre les hérésies, Irénée affirme l’unité du dessein divin : le Dieu qui parle à Abraham est celui qui se révèle dans le Christ. Dans Contre Marcion, Tertullien montre avec force que l’Incarnation n’est pas une concession mais le cœur du salut : si le Christ n’a pas assumé la chair, la chair n’est pas sauvée.
Après la condamnation de Marcion par l’Eglise, c’est ce paradoxe providentiel qui lui permet d’entreprendre de fixer le canon des Écritures, soit l'ensemble des livres reconnus comme inspirés par l’Esprit Saint. Ainsi, cette déchirure devient un moment de clarification et d’approfondissement de la foi.
Quant à Marcion, il meurt probablement dans les années qui suivent, loin de Rome, mais entouré de ses disciples. Ses communautés survivront plusieurs siècles encore, avant de s’effacer comme un ruisseau qui s’assèche.
Pour l’Église, son histoire demeure un avertissement intérieur : il est possible de chercher Dieu avec sincérité et de se perdre en oubliant que Dieu vient à nous dans l’histoire, dans la chair, dans le réel. La vérité chrétienne n’est pas une fuite hors du monde, mais l’accueil de Dieu fait homme, venu sanctifier ce qu’Il a créé.
Avec Hozana, nourrissez chaque jour votre foi !
Avec Hozana, goûtez la force de la prière partagée : des communautés vivantes vous accompagnent pour redécouvrir, nourrir et approfondir votre foi, jour après jour.
Découvrez par exemple :
cette communauté vous permettant de , pilier de la foi catholique.
cette neuvaine pour avec Sainte Thérèse de Lisieux
voici encore pour se souvenir de la miséricorde de Dieu