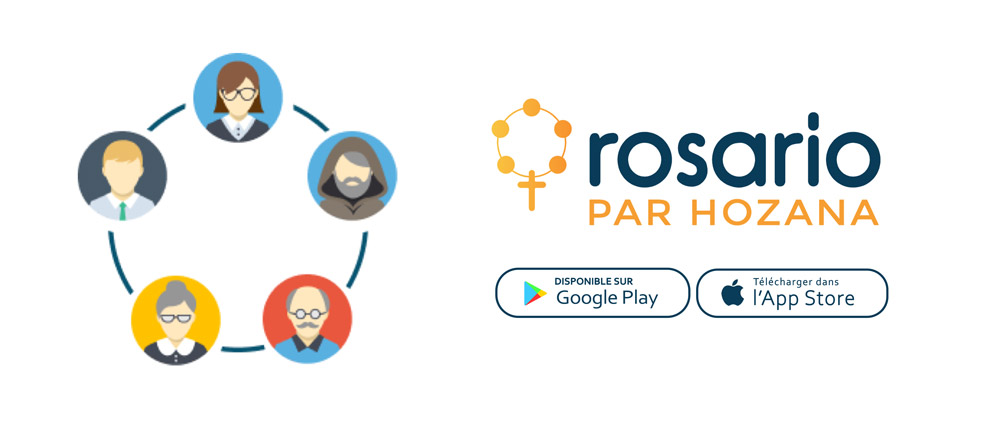Marguerite Porete, une âme libre oubliée de l'Église
Au XIIIe siècle, à l’heure où l’Europe chrétienne se couvre de cathédrales et d’institutions scolastiques, une femme choisit de parler autrement de Dieu. Ni moniale ni épouse, elle appartient à ce peuple discret et fervent des béguines, ces femmes libres et dévouées, qui vivent entre monde et cloître, en quête d’une union intérieure avec le divin. L'œuvre de Marguerite Porete, d’une audace sans pareille, traverse les âges.
Précurseuse des grandes voix de la mystique rhénane — Maître Eckhart, Tauler, Suso — elle écrit dans une langue limpide un chemin de dépouillement radical : Le Miroir des âmes simples anéanties. Là, elle ose dire qu’une âme unie à Dieu peut se passer de règles, de mérites, de volontés humaines, car elle se perd dans l’Amour pur, là où il n’est plus question que de Dieu en Dieu.
Ce souffle, jugé trop libre, trop pur, trop féminin peut-être, la conduira au bûcher. Mais son silence, scellé dans les flammes, parle encore. Qui était-elle? Quelle est son histoire et son héritage?
Qui était-elle ? Une femme dans son époque
On sait peu de choses de Marguerite Porete. Elle naît au cœur du XIIIe siècle, sans doute dans le comté du Hainaut, c'est-à-dire aujourd’hui entre Mons et Valenciennes. Son nom véritable n’est pas connu car Porete est un surnom. Au sein d’une société chrétienne dominée par les structures cléricales et les formes extérieures de piété, Marguerite choisit le chemin des béguines, femmes pieuses vivant en communauté, sans vœux définitifs, libres d’aimer Dieu hors des murs du couvent. Une voie de ferveur et de liberté, que l’Église regarde parfois avec méfiance.
Se décrivant comme une “mendiante créature” Marguerite n’est pas théologienne, ni docteure de l’Université, mais elle parle de Dieu avec une profondeur qui déroute. “Béguines disent que je suis dans l'erreur, ainsi que prêtres, clercs et prêcheurs, augustins et carmes et les frères mineurs”. Son langage est simple, et il déplait. Elle rédige un premier ouvrage L’être de l’affinée amour, qui s’oriente vers le dépouillement intérieur, dans une quête que l’on retrouvera bientôt chez les grands noms de la mystique rhénane qu’elle précède pourtant. Avant Eckhart, elle murmure déjà que l’âme, anéantie en elle-même, peut se fondre dans l’Amour divin jusqu’à ne plus vouloir que Dieu seul. Son ouvrage est brûlé à la fin du XIIIè sur les ordres de l'évêque de Cambrai qui lui interdit de renouveler le moindre écrit sous peine d’être jugée hérétique. Follement amoureuse de Dieu, elle n’a rien de rebelle mais vit pleinement sa liberté, et c’est sûrement ce qui est le plus insupportable pour l’époque. C’est dans cet esprit de liberté qu’elle réitère avec Le miroir des âmes simples.
Le Miroir des âmes simples : une parole radicale
Le Miroir des âmes simples anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d’Amour, rédigé non en latin mais dans la langue du peuple (ancien français), se veut un chant adressé aux âmes profondes, détachées de tout, prêtes à se perdre en Dieu. Dans un dialogue entre l’âme, la raison, l’amour et d’autres figures allégoriques, Marguerite trace le chemin d’un dépouillement extrême, jusqu’à l'anéantissement de soi. Elle distingue sept grâces initiatiques après lesquelles l'âme atteint à la jouissance de Dieu et s'annihile en lui. L’âme, dans son plus haut degré d’union, perd alors sa volonté, ses désirs, son essence, et cesse même de vouloir aimer Dieu : elle ne fait plus qu'être en Lui. Il n’y a là ni ascèse spectaculaire ni exaltation émotionnelle, seulement une présence nue, paisible, absolue.
Cette parole est radicale, car elle dépasse les cadres. Elle conteste, sans l’attaquer, la médiation institutionnelle, c'est-à-dire l’Eglise. Elle déplace l’expérience de Dieu du domaine des rites vers celui de l’intime. Une telle liberté intérieure, affirmée par une femme, en dehors de toute autorité reconnue, ne pouvait qu’alarmer les gardiens de l’orthodoxie.
Le procès et le feu : condamnation de l’Eglise
Le Miroir des âmes simples anéanties, circule dès la fin du XIIIe siècle dans les milieux spirituels. Il attire rapidement l’attention des autorités ecclésiastiques. Dès 1306, l’évêque de Cambrai condamne l’ouvrage et ordonne qu’il soit brûlé. Marguerite refuse de se soumettre. Elle continue à diffuser son texte, convaincue qu’il ne contient rien que l’amour de Dieu n’ait lui-même inspiré.
Elle est arrêtée à Paris vers 1308, sur décision de l’Inquisition. Commence alors une longue détention, de plus d’un an. Marguerite, convoquée à comparaître, refuse toute défense. Elle ne plaide pas sa cause, n’abjure pas, ne commente pas. Ce silence obstiné, intrigue ses juges, mais aggrave aussi sa position. On la considère comme hérétique non repentie.
Le tribunal inquisitorial, composé de docteurs de la Sorbonne et de religieux influents, examine attentivement son œuvre. On lui reproche notamment d’enseigner que l’âme parvenue à l’union divine n’a plus besoin ni de la loi ni des sacrements. Vingt et une propositions extraites de son livre sont déclarées fausses ou dangereuses. Elle est reconnue coupable d’hérésie et, surtout, de relapse (récidive).
Le 31 mai 1310, le roi Philippe le Bel approuve l’exécution. Le lendemain, 1er juin, Marguerite Porete est conduite sur la place de Grève, à Paris. Là, devant une foule nombreuse, elle est brûlée vive. Elle meurt dans le silence, sans renier un mot. Aucun écrit ne rapporte ses dernières paroles, aucun témoin ne décrit un geste.
Postérité, héritage de Marguerite Porète
Après le bûcher, le nom de Marguerite Porète disparaît des chroniques. Son livre, condamné, circule pourtant dans l’ombre, souvent recopié, rarement signé. Privée d’auteur, l’œuvre survit pourtant à travers les âges. Cependant, il faut attendre la fin du XXe siècle pour que son nom ressurgisse enfin, grâce à une chercheuse italienne qui l’identifie formellement comme l'auteur du Miroir des âmes simples. Des historiens, des théologiens, des chercheuses, parfois des moniales, redonnent visage à cette femme que l’on croyait effacée. L’ouvrage, peu à peu, reprend sa place dans le patrimoine mystique chrétien. Et ce qu’on y découvre frappe par sa modernité : une foi sans mesure, une liberté intérieure qui n’exclut pas l’Église.
Marguerite ne propose pas une révolte, mais une offrande. Ce qu’elle appelle “anéantissement”, ce n’était pas l’oubli de Dieu, mais l’oubli de soi, dans une confiance si pure qu’elle devient abandon. Elle rejoint, par cette nudité d’âme, la grande lignée des mystiques : Maître Eckhart, Jean de la Croix, Thérèse d’Avila, Simone Weil. Tous, à leur manière, ont entendu l’appel à ne plus se posséder soi-même, mais à se laisser habiter.
Aujourd’hui, Marguerite Porète n’a pas encore été pleinement réhabilitée par l’Eglise. Mais son héritage se transmet autrement : dans le silence des prières, dans la lecture fervente de son Miroir, notamment par des communautés de religieuses, dans la vie intérieure de celles et ceux qui, comme elle, cherchent à se perdre en Dieu pour mieux le laisser être en eux. Sa parole, que le feu n’a pu consumer, traverse le temps.
Découvrez comment développer votre vie intérieure à la manière de Marguerite Porète sur Meditatio
Meditatio est la première application francophone entièrement dédiée à la méditation chrétienne. Elle met à votre disposition une riche palette de contenus audio pour vous accompagner dans la prière silencieuse et la méditation de la Parole de Dieu. Explorez des parcours inspirants pour approfondir les grandes traditions méditatives du christianisme, ou le programme sur la vie intérieure, inspiré des Pères du Désert.
L’application est gratuite : téléchargez-la et laissez-vous guider sur le chemin intérieur, jour après jour.